le portail de la science politique française
le portail de la science politique française
L’Observatoire des atteintes à la liberté académique (OALA) est un organisme conjoint à l’Association Française de Science Politique et à l’Association Française de Sociologie créé en 2023.

L’Observatoire peut être sollicité par toute personne (titulaire ou non) subissant une forme quelconque de violence en raison de ses recherches. Il conseille et soutient les victimes, assure un suivi des affaires auprès des deux associations ainsi que la coordination de leurs éventuelles actions communes.
L’Observatoire vise également à sensibiliser les enseignant·e·s et les chercheur·euse·s aux menaces qui pèsent sur la liberté académique, ainsi qu’à les informer sur les manières de s’en protéger. L’espace web de l’OALA assure à cet effet une veille en recensant les atteintes à la liberté académique. Il renseigne sur les droits des enseignant·e·s et les chercheur·euse·s en documentant les ressources juridiques à leur disposition (textes de lois, jurisprudence, rapports parlementaires, liste d’avocats spécialisés, etc.).
Il permet aussi une transmission des connaissances théoriques et de savoirs pratiques via une série de capsules vidéo réalisées avec des juristes, des collègues ayant vécu une situation préjudiciable ou ayant une expertise sur un sujet lié (la garde à vue, la protection des données, le harcèlement sur les réseaux sociaux, etc.). Cet espace internet se veut enfin et surtout un lieu d’évocation des possibles modalités de défense individuelles et collectives pour se prémunir ou lutter contre ces attaques qui peuvent toucher chacune et chacun d’entre nous.
L’Observatoire est piloté par un bureau exécutif, présidé par Delphine Dulong et Vanessa Codaccioni, qui coordonne l’action d’un comité stratégique composé de politistes et de sociologues (Maira Abreu, Philippe Aldrin, Thibaud Boncourt, Laurent Bonelli, Elodie Chauvin, Alexandre Dézé, Jules Falquet, Camille Gourdeau, Jérôme Heurtaux, Fabien Jobard, Annalisa Lendaro, Igor Martinache, Clément Rivière, Gisèle Sapiro).
#Mobilisation Pour l’acquittement définitif de Pinar Selek le 21 octobre 2025 !
Le mardi 21 octobre 2025 aura lieu à Istanbul la 6e audience du 5e procès à l’encontre de notre collègue sociologue et écrivaine franco-turque Pinar Selek. L’Association Française de Science Politique renouvelle son soutien indéfectible à Pinar Selek et réaffirme sa détermination pour que celle-ci soit définitivement acquittée et libérée d’un inacceptable harcèlement politico-judiciaire. L’OALA publie à cette occasion une nouvelle capsule vidéo en hommage à Pinar Selek : « Plus d’un quart de siècle de persécution et de résistance ».
En savoir plus…

#AAC Silence sur les campus. Menaces globales contre la liberté académique
L’OALA vous informe qu’un appel à contributions est lancé pour un ouvrage collectif provisoirement intitulé « Silence sur les campus. Menaces globales contre la liberté académique ». Pour ce nouvel opus de l’Enjeu mondial, qui sera publié aux Presses de Sciences Po en 2026 sous la direction de Stéphanie Balme, les propositions de contributions sont à envoyer avant le 20 juin 2025.
Pour en savoir plus…
#Capsule Une nouvelle vidéo en mars 2025 : « Massacre à la tronçonneuse : la recherche publique sous Milei »
#NEW Publication de La Lettre de l'OALA n°1 (février 2025)

#ProcédureBaillon
Relaxe du chercheur Maxime Audinet (IRSEM) dans le cadre d’une procédure bâillon intentée par Russia Today.
Une plainte en diffamation contre son livre Russia Today (RT) : Un média d’influence au service de l’Etat russe (INA, 2021, réédité en 2024) avait été déposée par la chaîne RT France le 20 janvier 2022, un mois avant l’invasion de l’Ukraine et la suspension consécutive du réseau RT au sein de l’UE. RT France attaquait 9 passages de son livre. Il a été mis en examen le 4 avril 2024 et le procès en première instance s’est tenu le 5 février 2025. Maxime Audinet a été relaxé à l’issue même de l’audience, aucun passage n’ayant été jugé diffamatoire par le tribunal, et le tribunal a débouté RT France de sa plainte.
#International
L’indépendance de la science et de l’éducation relève des libertés les plus fondamentales des démocraties. En temps de crise, il apparaît que cette indépendance ne va plus forcément de soi, mais doit au contraire être sans cesse défendue – et ce même au sein de l’Union Européenne. A l’automne 2024, la Fondation Genshagen a invité des experts de France, d’Allemagne et de Pologne à un colloque intitulé « Renforcer l’indépendance de la science et de l’éducation pour une Europe libre ». Parmi les spécialistes venus échanger sur les moyens de garantir l’indépendance de la recherche et de la transmission des savoirs, la politiste française Delphine Dulong, présidente de l’Observatoire des atteintes à la liberté académique (OALA). Retour sur les temps forts et conclusions de ce colloque « pour l’avenir ».
#ProcédureBaillon
« Faire taire en faisant peur » : l’article du dernier MagAFSP n°7 de décembre 2024 qui revient sur une procédure bâillon, celle de l’IFOP contre le politiste Alexandre Dézé.
Le 4 octobre 2024, l’IFOP se désistait après une plainte déposée en 2020 pour diffamation contre Alexandre Dézé, politiste montpelliérain spécialiste des sondages. Retour sur deux années de procédure abusive portant atteinte à la liberté académique et révélatrice d’un risque plus global : la judiciarisation des controverses scientifiques. Lire l’article…
Qui sommes-nous ?
L’OALA est un organisme qui veille au respect de la liberté académique en sciences humaines et sociales. Créé par deux associations professionnelles, l’Association Française de Science Politique et l’Association Française de Sociologie, il est animé par des enseigants·es et/ou chercheurs·ses bénévoles.
Il est composé d’un bureau exécutif qui assure la coordination des actions menées au nom des deux associations et d’un comité stratégique composé de sociologues et politistes qui disposent d’une expertise pratique ou théorique sur les atteintes à la liberté académique. Leurs membres sont désignés par les conseils d’administration des deux associations.
Que faisons-nous ?
L’OALA a d’abord une mission préventive. Il sensibilise aux risques et menaces qui pèsent sur la liberté académique et informe sur les droits des enseignants·es et/ou chercheurs·ses. À cette fin, il se charge également d’accumuler et de transmettre des savoirs pratiques issus de l’expérience individuelle et collective.
L’OALA assure ensuite une mission de conseil et de soutien auprès de celles et ceux qui le sollicitent lorsqu’ils ou elles sont victimes d’une forme d’atteinte à la liberté publique ou se voient injustement refuser une demande de protection fonctionnelle.
L’OALA instruit également pour l’AFSP et l’AFS les demandes de soutien public et coordonne leurs actions collectives, y compris avec d’autres partenaires sur les thématiques relatives à la liberté académique.
L’OALA dresse enfin un état des lieux annuel en France sur la liberté académique. Organe de réflexion, il est aussi force de proposition auprès des pouvoirs publics.
Contact : observatoireoala@gmail.com
L’Observatoire est piloté par un bureau exécutif, présidé par Delphine Dulong et Vanessa Codaccioni, qui coordonne l’action d’un comité stratégique composé de politistes et de sociologues (Maira Abreu, Philippe Aldrin, Thibaud Boncourt, Laurent Bonelli, Elodie Chauvin, Alexandre Dézé, Jules Falquet, Camille Gourdeau, Jérôme Heurtaux, Fabien Jobard, Annalisa Lendaro, Igor Martinache, Clément Rivière, Gisèle Sapiro).
Communiqué de lancement de l’OALA (30 mars 2023) :
Qu’est-ce que la liberté académique ? Quels sont ses fondements juridiques ? En quoi est-elle menacée et par qui ? Comment protéger ses données d’enquête ? Que faire si on est interpellé lors d’une observation sur son terrain ? Ce sont à toutes ces questions, et bien d’autres encore, que répondent les capsules vidéos. Celles-ci vous informent « vite fait bien fait » sur les risques et les ficelles du métier grâce à des enseignants·es et/ou chercheurs·ses qui viennent ici partager leur expertise, leur expérience ainsi que leur bibliographie sur le sujet traité.
CAPSULE #1 — La liberté académique en droit
Avec Stéphanie Hennette-Vauchez
Existe-t-il un régime juridique encadrant la liberté académique ? Quels sont les textes législatifs et constitutionnels qui garantissent l’indépendance et la liberté d’expression des enseignant.e.s chercheur.ses ? Quel rôle joue dans cet encadrement la Loi de Programmation de la Recherche ? En revenant sur le cadre juridique et les dispositions les plus récentes, Stéphanie Hennette-Vauchez, professeure de droit public à l’Université Paris Nanterre, rappelle le caractère lâche de la notion de liberté académique. Mais elle évoque surtout les menaces pesant sur elle, comme la censure, les procédures-bâillons, les accusations diverses contre telle ou tel collègue, les difficultés d’accès à certaines sources etc., différentes formes d’atteintes qui reflètent un ensemble de tentatives de soumission de la recherche à des impératifs politiques ou économiques.
Voir la vidéo…
CAPSULE #2 — L’éthique de ou contre la recherche
Avec Johanna Siméant-Germanos
La régulation éthique de la recherche est aujourd’hui au cœur des atteintes à la liberté académique. Science ouverte, RGPD, formulaires de consentement, contrôle de la déontologie par des acteurs extérieurs aux SHS dans les comités d’éthique, tous ces dispositifs produisent de la censure, de l’autocensure et perturbent si ce n’est dégradent la relation d’enquête. Dans cet entretien et à partir de ce constat alarmant, Johanna Siméant-Germanos, professeure de science politique et directrice du département de sciences sociales de l’ENS, nous invite à penser et à mettre en œuvre des résistances et des actions collectives allant de la désobéissance à bas bruit à la réappropriation des normes éthiques.
Voir la vidéo…
CAPSULE #3 — Un nouveau régime de surveillance ?
Avec Philippe Aldrin, autour du livre L’enquête en danger
L’ouvrage L’enquête en danger s’inscrit, comme le rappelle Philippe Aldrin, professeur de science politique à l’IEP d’Aix-en-Provence, dans le contexte d’une production éditoriale foisonnante sur les atteintes à la liberté académique et sur les menaces qui pèsent sur la recherche en sciences sociales. Il s’en distingue néanmoins d’une part en rassemblant des contributions de chercheuses et de chercheurs travaillant sur des terrains dits « difficiles », dans les États autoritaires ou policiers, mais aussi en menant des recherches en Europe ou en France ; et d’autre part en focalisant sur les logiques de surveillances (managériales, éthiques, policières) qui entravent l’autonomie en sciences sociales.
Voir la vidéo…
CAPSULE #4 — La protection des données
Avec Laurent Bonelli
Contrairement aux journalistes, les enseignants·es chercheurs·es ne bénéficient en France d’aucun statut juridique spécial permettant de protéger leurs sources. En attendant de voir ce vide juridique comblé, il est donc prudent lorsque l’on étudie des sujets sensibles de protéger ses données d’enquêtes. On vous explique comment dans cette capsule avec Laurent Bonelli, maître de conférences en science politique à l’Université Paris Nanterre et membre de l’Institut des sciences sociales du politique.
Voir la vidéo…
CAPSULE #5 — La garde à vue
Avec Fabien Jobard
Quel que soit leur terrain, les enseignants·es chercheurs·es ne sont pas à l’abri d’une interpellation par les forces de l’ordre et d’un placement en garde à vue tant le cadre légal de celle-ci est large. Dans cette capsule, Fabien Jobard, directeur de recherche CNRS au Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales (CESDIP), objective en sociologue cette procédure et en tire des conclusions contre-intuitives : parce que tout le dispositif vise à éviter un procès public, il vous invite à ne pas transiger.
Voir la vidéo…
CAPSULE #6 — Attention réseaux sociaux !
Avec Anne Cousin
Avec le développement des réseaux sociaux, la liberté d’expression se retourne de plus en plus souvent contre la liberté académique : chercheurs·ses harcelés·es, enseigants·es diffamés·es, parfois menacés·es, etc. Anne Cousin, avocate au barreau de Paris et spécialiste du droit numérique, vous donne quelques conseils simples : réagir vite et conserver des traces.
Voir la vidéo…
CAPSULE #7 — L’accès aux terrains « difficiles »
Avec Laura Ruiz de Elvira
En contexte démocratique et a fortiori autoritaire, l’accès à certains terrains « difficiles » (zone de conflit, population d’enquêtés·es stigmatisée, sujets « sensibles » pour les autorités politiques, etc.) peut prendre la forme d’une véritable course d’obstacles. Laura Ruiz de Elvira, chargée de recherche à l’IRD (CEPED), spécialiste de la Syrie et membre du groupe AFSP NATER – (Non) Acccès au terrain –, décrit les nombreux problèmes et questions que soulèvent ces terrains particuliers et vous donnent quelques conseils.
Voir la vidéo…
CAPSULE #8 — La plainte pour diffamation
Avec Alexandre Dézé
La plainte pour diffamation, ça n’arrive pas qu’aux autres. Comme en témoigne dans cette capsule vidéo Alexandre Dézé (maître de conférences en science politique à l’Université Montpellier 1 et chercheur au Centre d’Etudes Politiques Et sociaLes). Après avoir critiqué dans le journal Le Monde la méthodologie d’un sondage produit par l’IFOP sur l’opinion des Français et des Français de confession musulmane sur les attentats de Charlie Hebdo, et dénoncé l’exploitation qu’en a fait la chaîne de TV CNews, il a été mis en examen pour diffamation par l’institut de sondage.
Voir la vidéo…

CAPSULE #9 — La protection fonctionnelle
Avec Christelle Rabier
Tout agent de la fonction publique, qu’il.elle soit fonctionnaire ou contractuel.le, a le droit d’être protégé.e par son administration lorsqu’il.elle est menacé.e ou empêché.e dans le cadre de ses missions. La procédure est simple et la protection en principe très large : elle couvre la famille de l’agent et tout frais lié au problème, notamment les frais de justice. Cependant, en raison de la multiplication des atteintes à la liberté académique, l’administration est de plus en plus tentée de limiter les coûts de ce droit et il faut parfois se battre pour obtenir une protection à la hauteur des enjeux. C’est ce qui est arrivé à Christelle Rabier (MCF à l’EHESS en histoire des sciences). Dans cette capsule, elle vous raconte sa mésaventure et vous explique pourquoi il est non seulement légitime mais important pour la liberté académique d’obtenir une réelle protection de l’administration.
Voir la vidéo…
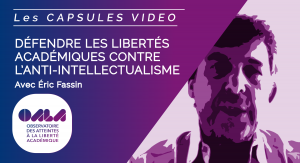
CAPSULE #10 – Défendre les libertés académiques contre l’anti-intellectualisme
Avec Éric Fassin
La question des libertés académiques s’est tout particulièrement posée dans le contexte des attaques contre les études de genre et post-coloniales. Eric Fassin, professeur de sociologie à Paris 8, membre sénior de l’IUF et chercheur au LEGS, revient sur ces attaques et les analyses en soulignant leurs effets : au-delà des menaces intuitu personae contre les chercheurs·ses et des risques de désinvestissement dans des domaines de connaissances scientifiques considérés comme risqués ou controversés, l’amalgame fait entre savoirs critiques et opinion par les auteurs de ces attaques cache un anti-intellectualisme dangereux pour la démocratie.
Voir la vidéo…
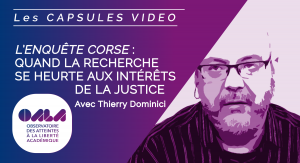
CAPSULE #11 – L’enquête corse : quand la recherche se heurte aux intérêts de la justice
Avec Thierry Dominici
Justice et recherche ne font parfois pas bon ménage. Lorsqu’une enquête se heurte aux intérêts de la justice, le ou la chercheur•se s’expose à plusieurs risques : garde à vue, saisie des données, suspicion de tout bord. Lorsque cela arrive, c’est David contre Goliath et le choc peut être violent. Ce type d’incident signe en effet la fin de la recherche et agit comme un poison lent. Dans cette capsule vidéo, Thierry Dominici, maître de conférences en science politique à l’Université de Bordeaux, témoigne de ce qui lui est arrivé lors de sa recherche doctorale – avortée – sur l’Armata Corsa et des conséquences à long terme sur sa carrière et sa santé.
Voir la vidéo…
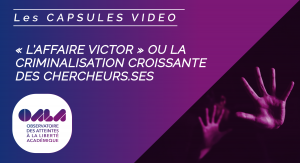
CAPSULE VIDEO #12 – « L’affaire Victor » ou la criminalisation croissante des chercheurs.ses
Le 19 octobre 2024, Victor, un jeune doctorant français de l’IREMAM, était arrêté avec sa compagne en Tunisie et jeté en prison pour « atteinte à la sûreté de l’Etat ». Dans cette capsule, son directeur de thèse, Amin Allal (CERAPS), et son directeur de laboratoire, Vincent Geisser (IREMAM), reviennent sur ce drame, en proposent une analyse et en retiennent quelques leçons avec l’OALA : infantilisée par le pouvoir exécutif, la recherche française est bien mal préparée face aux risques que l’autoritarisme identitaire fait de plus en plus encourir à ses membres. Outre l’absence de protocole et de réflexe corporatiste dans la communauté scientifique, son mode de fonctionnement et sa faible audience médiatique compliquent la prise en charge et freine la résolution des problèmes lorsque l’arbitraire frappe. Face à la suspicion croissante qui pèse sur les chercheurs.ses, il faut donc collectivement plaider pour un droit à la recherche.
Voir la vidéo…
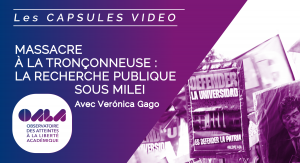
CAPSULE VIDEO #13 – Massacre à la tronçonneuse : la recherche publique sous Milei
Avec Verónica Gago
Depuis leur arrivée au pouvoir en janvier de 2025, D. Trump et E. Musc ont entrepris une chasse aux sorcières qui impacte notamment les universitaires : données effacées ou rendues inaccessibles ; collaborations internationales empêchées ; censure de certains mots, articles ou revues ; coupes budgétaires, etc. Tous ces faits sont bien documentés par la presse et le mouvement Stand up for Science. Moins connu en revanche est le fait que Trump suit un modèle qui se veut transnational, celui de « l’anarcho capitaliste » Javier Milei. Le DOGE (Department of Government Efficiency) a en effet un précédent : le ministère de la Dérégulation et de la transformation de l’État en Argentine. En une année, au rythme de plus d’une déréglementation par jour, l’inflation délirante en Argentine a baissé mais au prix, entre autres, du sacrifice de l’université publique, pilier de la mémoire des luttes pour la démocratie et instrument de justice sociale en Argentine. Verónica Gago, théoricienne du féminisme à l’Université de Buenos Aires, en témoigne dans cette capsule.
Voir la vidéo…

CAPSULE VIDEO #14 – Plus d’Un quart de siècle de persécution et de résistance.
Avec Pinar Selek
La sociologue Pinar Selek est persécutée par le régime turc depuis vingt-sept ans. Exilée en France, elle est chercheuse à l’URMIS. Dans un entretien avec Gisèle Sapiro et Elsie Cohen pour l’OALA, réalisé le 26 octobre 2024, elle témoigne des atteintes à ses libertés académiques. En voici des extraits.
Voir la vidéo…
À (re)lire également, le grand entretien du MagAFSP n°7 qui était consacré en décembre 2024 à Pinar Selek : « Il me faut construire une stratégie du “persiste et signe”. (…) Le pire serait de faire profil bas. »
SAVE THE DATE Chaque mois, vous pourrez découvrir de nouvelles capsules vidéo. Abonnez-vous à la newsletter AFSP pour être informé.e des nouveautés !
Retrouvez ici les focus et prises de position de l’OALA : ses informations sur les situations où la liberté académique est mise en cause, ses communiqués de soutien aux victimes, ses indignations, ses interpellations d’auteurs d’atteinte à la liberté académique, les événements auxquels l’OALA participe ou qu’il organise, ou encore ses recommandations.
Juillet 2025
L’OALA dans Le Monde le 5 juillet 2025 : « Aux racines de la liberté académique, rempart contre l’arbitraire et fragile pilier des démocraties libérales »
Lire l’article…
Mai 2025
Interview de Delphine Dulong « L’Observatoire des atteintes à la liberté académique » dans la VRS n°440 – Dossier – Liberté académique : résister à la délégitimation du pouvoir
Lire l’entretien…
Mai 2025
Webinaire de la SEMOMM le 22 mai 2025 sur les actions de l’Observatoire des atteintes à la liberté académique
Dans le cadre de son webinaire sur les libertés académiques, la SEMOMM invite à sa séance du 22 mai 2025 Delphine Dulong, Professeure des Universités à l’Université Panthéon Sorbonne et Jérôme Heurtaux, Maître de conférences à l’Université Paris Dauphine – PSL, tous deux respectivement Présidente et membre de l’Observatoire des atteintes à la liberté académique (OALA). Les deux intervenants présenteront les missions de l’Observatoire, reviendront sur les principaux enjeux contemporains en matière de liberté académique et répondront aux questions des collègues.
En savoir plus…
Janvier 2025
Tribune collective signée par l’OALA et l’AFSP dans Le Monde le 7 janvier 2025
« Les pouvoirs publics français doivent protéger leurs chercheurs et la liberté académique »
Les menaces et poursuites intentées contre des universitaires travaillant en France ne cessent de se multiplier, s’alarme, dans une tribune au « Monde », un collectif de présidents d’association pour la défense des libertés académiques
Lire la tribune…
Novembre 2024
Journée d’étude « La liberté académique à l’épreuve des enjeux contemporains ? » organisée à Sciences Po Lille le 14 novembre 2024 dans le cadre de l’exposition « Poser pour la liberté : portraits de scientifiques en exil ». En présence de de l’OALA.
En savoir plus…
Novembre 2024
Pour la libération immédiate du chercheur français Victor Dupont détenu depuis le 19 octobre 2024 en Tunisie
Octobre 2024
L’audience du procès qui oppose notre collègue Alexandre Dézé à l’IFOP s’est déroulée vendredi 4 octobre 2024. En raison du désistement de l’institut de sondages à 48 heures de l’échéance, les discussions se sont déplacées sur le caractère abusif de la procédure, assortie d’une demande de dommages et intérêts, avec un délibéré au 12 novembre. L’AFSP, présente à l’audience, se félicite de ce premier dénouement et du terme apporté à une procédure bâillon inacceptable. Elle apporte à nouveau son soutien à Alexandre Dézé en vue de l’audience du 12/11.
Pour plus d’informations, lire l’article publié en décembre 2024 dans le MagAFSP #7…
Juin 2024
Amplifions la mobilisation pour Pinar Selek d’ici le 28 juin 2024 !
Mars 2024
Liberté académique, liberté des scientifiques : nouveaux dangers, nouveaux chantiers
Novembre 2023
Quelles propositions innovantes pour défendre la liberté académique ?
Septembre 2023
Justice et liberté pour Pinar Selek !
Mai 2023
Défis pour la liberté académique en tant que droit fondamental
Mars 2023
72 heures de Solidarité avec Pinar Selek du 29 au 31 mars 2023
Mars 2023
Mobilisation pour la protection et l’acquittement définitif de Pinar Selek
Février 2023
Notre collègue Fariba Adelkhah, prisonnière scientifique en Iran depuis 2019, est sortie de prison
Janvier 2023
Soutien à Pinar Selek, sociologue franco-turque persécutée par le gouvernement d’Ankara
Janvier 2023
Soutien à Samuel Legris
La Lettre de l’OALA dresse un bilan annuel sur la liberté académique en sciences humaines et sociales. Cette veille porte sur les atteintes recensées tout au long de l’année ainsi que sur l’évolution des menaces tant juridiques, économiques que politiques qui pèsent sur la liberté académique. Destinée en priorité aux membres de la communauté académique, la Lettre de l’OALA est également diffusée aux médias et aux pouvoirs publics.
La Lettre de l’OALA n°1 (février 2025)
Dans le cadre de ses missions d’information et de prévention, l’OALA a vocation à rassembler et dans certains cas synthétiser toute une série de documents utiles : bibliographie sur le thème de la liberté académique, rapports parlementaires, textes juridiques, liste d’avocats spécialisés, vademecum sur la protection fonctionnelle, etc. Cette rubrique a vocation à s’enrichir progressivement et de façon collaborative.
Les informations de cette rubrique seront progressivement mises en ligne. Pour contribuer à la démarche collaborative et envoyer des suggestions de contenus : observatoireoala@gmail.com
« Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d’une pleine indépendance et d’une entière liberté d’expression dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d’objectivité.
Les libertés académiques sont le gage de l’excellence de l’enseignement supérieur et de la recherche français. Elles s’exercent conformément au principe à caractère constitutionnel d’indépendance des enseignants-chercheurs ».
Article L952-2 du Code de l’éducation
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020
Modifié par LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 – art. 15
Anne Cousin (droit du numérique)
Avocate au barreau de Paris
SCP Herald, anciennement Granrut
91, rue du Faubourg Saint Honoré – 75008 Paris
01 53 43 15 15 / 01 53 43 12 95
06 13 02 63 11
www.herald-avocats.com
Aïnoha Pascual
Avocate au Barreau de Paris
204 rue de Vaugirard – 75015 Paris
07.68.97.17.68
Raphaël Kempf (défense pénale, droit des étrangers et libertés fondamentales)
Avocat au barreau de Paris
7, rue Chaptal – 75009 Paris
06-28-06-37-93
kempfavocat@gmail.com
David Mendel (défense pénale, garde à vue)
Avocat au barreau de Montpellier
22 Rue Durand – 34000 Montpellier
https://www.davidmendel-avocat.fr
Tél. 04 67 02 42 26
Port. 06 12 72 72 60
davidborgnetmendel@hotmail.com
Laure Mazurier (droit de la presse, droit des médias, diffamation, harcèlement et dénigrement)
Cabinet Joshua 17, boulevard Montmartre – 75002 PARIS
www.joshua-avocats.com
Yuna Lesteven (droit des affaires et des contrats commerciaux, droit des nouvelles technologies et droit de la protection des données à caractère personnel)
Cabinet Joshua 17, boulevard Montmartre – 75002 PARIS
www.joshua-avocats.com
Tout fonctionnaire, qu’il soit stagiaire ou titulaire, bénéficie de la protection fonctionnelle s’il est victime d’une infraction à l’occasion ou en raison de ses fonctions. L’administration doit protéger l’agent, lui apporter une assistance juridique et réparer les éventuels préjudices subis.
Qui peut en bénéficier ? Dans quelles circonstances demander la protection fonctionnelle ? Quelles sont les aides apportées par l’administration ? Comment demander la protection fonctionnelle ?
Pour tout savoir, télécharger la fiche pratique de l’OALA dédiée à la protection fonctionnelle :
Textes de lois et références :
A lire aussi…
Depuis des années et régulièrement des enseignants-chercheurs sont l’objet de plaintes en diffamation ou en dénigrement, à la suite de leurs travaux scientifiques publiés dans des revues académiques ou dans la presse généraliste. Ces plaintes, dénommées « procédures bâillons », ont manifestement pour objet ou pour effet de porter atteinte à leur liberté d’expression. Sur la base de ce constat, une commission a été mise en place il y a quelques années par Thierry Mandon, secrétaire d’Etat chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et chargée de rédiger un rapport remis le 20 avril 2017.
La commission était ainsi composée :
– Camille Broyelle, professeur de droit public ;
– Emmanuelle Filiberti, présidente directrice générale du groupe Lextenso ;
– Valérie Malabat, professeur de droit privé ;
– Denis Mazeaud, professeur de droit privé, président de la commission ;
– Yves Surel, professeur de science politique.
Suite aux conclusions de ce rapport, une circulaire pour rappeler les modalités de la protection fonctionnelle des chercheurs et enseignants-chercheurs attaqués en diffamation a été envoyée aux universités en mai 2017.
A lire également…
Retrouvez ici des informations, analyses et initiatives autour de la défense des libertés académiques dans toutes les régions du monde.
Journée d’étude « La liberté académique à l’épreuve des enjeux contemporains ? » organisée à Sciences Po Lille le 14 novembre 2024 dans le cadre de l’exposition « Poser pour la liberté : portraits de scientifiques en exil ». En présence de représentants de l’OALA.
Colloque « Renforcer l’indépendance de la science et de l’éducation pour une Europe libre » (29 octobre 2024)
L’indépendance de la science et de l’éducation relève des libertés les plus fondamentales des démocraties. En temps de crise, il apparaît que cette indépendance ne va plus forcément de soi, mais doit au contraire être sans cesse défendue – et ce même au sein de l’Union Européenne. A l’automne 2024, la Fondation Genshagen a invité des experts de France, d’Allemagne et de Pologne à un colloque intitulé « Renforcer l’indépendance de la science et de l’éducation pour une Europe libre ». Parmi les spécialistes venus échanger sur les moyens de garantir l’indépendance de la recherche et de la transmission des savoirs, la politiste française Delphine Dulong, présidente de l’Observatoire des atteintes à la liberté académique (OALA). Retour sur les temps forts et conclusions de ce colloque « pour l’avenir ».
La liberté académique menacée dans le monde : « Les universitaires ont intérêt à s’exprimer ouvertement avant qu’il ne soit trop tard » (Le Monde, 01 avril 2024)
Aux Etats-Unis, la liberté académique assiégée (Le Monde, 01 avril 2024)
Academic Freedom Index
 Un rapport publié le 7 mars 2024 par une équipe germano-suédoise de chercheurs confirme que « la liberté académique est menacée dans le monde entier ». Budgets universitaires en berne, restrictions, voire suppressions de certains domaines de recherche, difficultés pour s’exprimer sur des sujets considérés comme sensibles… Leurs travaux, synthétisés dans un indice global dénommé « Academic Freedom Index », estiment que 45,5 % de la population mondiale, soit 3,6 milliards d’individus, vivent dans un environnement dépourvu de liberté académique.
Un rapport publié le 7 mars 2024 par une équipe germano-suédoise de chercheurs confirme que « la liberté académique est menacée dans le monde entier ». Budgets universitaires en berne, restrictions, voire suppressions de certains domaines de recherche, difficultés pour s’exprimer sur des sujets considérés comme sensibles… Leurs travaux, synthétisés dans un indice global dénommé « Academic Freedom Index », estiment que 45,5 % de la population mondiale, soit 3,6 milliards d’individus, vivent dans un environnement dépourvu de liberté académique.
Consulter ici le rapport 2024…